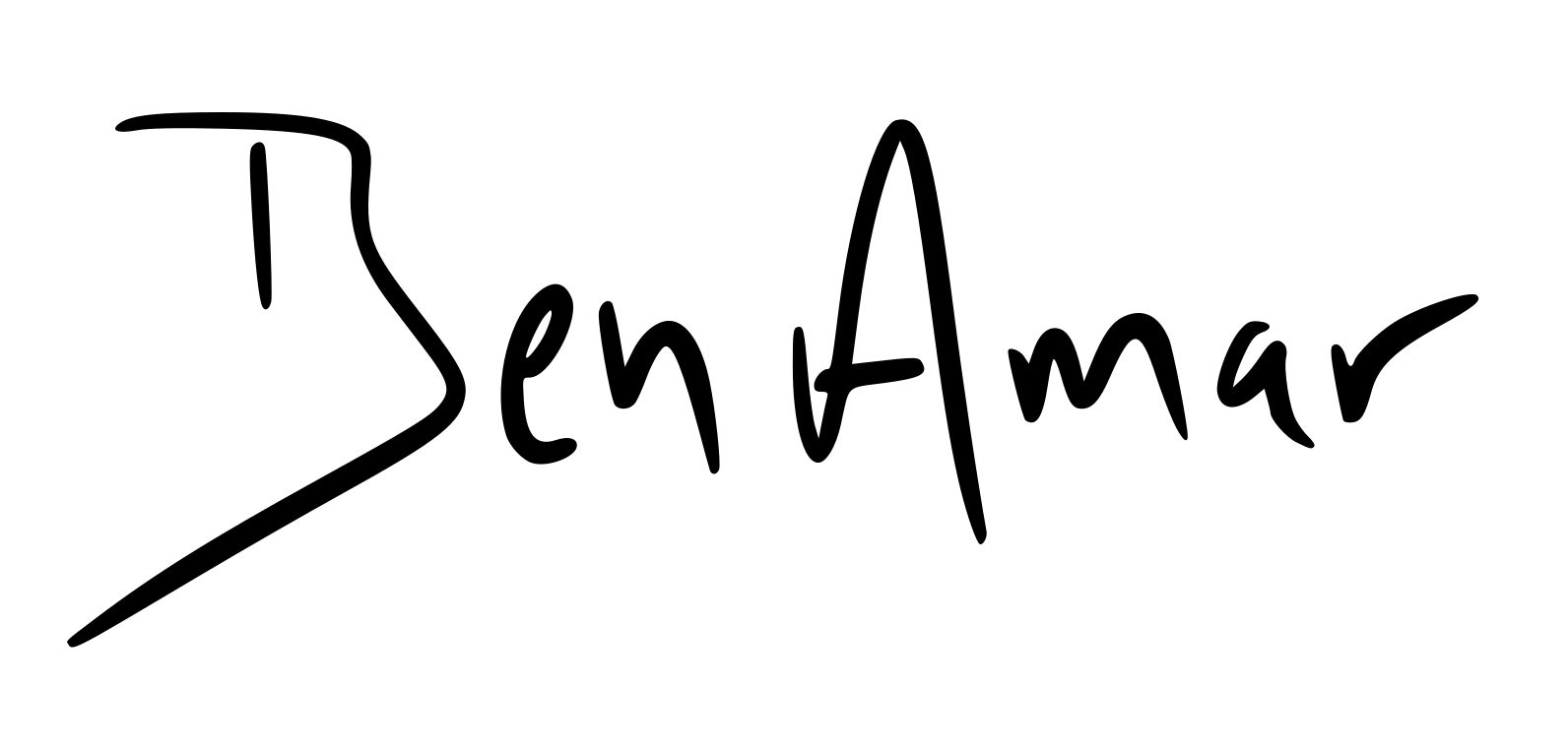Voila une heure que nous avons décollé, à bord d’un A320 Airbus, laissant Guangzhou derrière nous. Assis “côté couloir”, je n’ai pas de moyen de regarder par le hublot s’il est possible d’apercevoir quelques lueurs au sol alors que nous devrions approcher de Haikou. Pour l’instant tout ce qu’il m’est donné d’apercevoir depuis mon siège, c’est le noir total, interrompu brièvement par la lueur intermittente du flash de l’avion peinant à traverser l’épais brouillard qui nous entoure.
Je n’aime pas tellement ce segment de vol. Si, sur la carte, ces deux destinations semblent toutes proches, les conditions climatiques et l’orientation des pistes forcent souvent les pilotes à effectuer toutes sortes de manœuvres difficilement interprétables pour un passager. Dans la cabine, c’est la pénombre, pas le moindre écran pour vous donner ne serait-ce qu’une position sur la carte. Je n’ai que ma montre pour m’indiquer que nous aurions dû atterrir il y a 20 minutes. Nous sommes en phase d’approche et tout le monde semble dormir paisiblement lorsque soudain, le grondement des réacteurs tire tous les passagers de leur sommeil alors que l’avion reprend de l’altitude de manière précipité. Maintenant expectatifs, ballotés par les turbulences, les gens regardent en vain par les hublots à la recherche de repères que le brouillard ne laisse entrevoir. Je ne sais pas s’il est préférable de s’y connaître un peu en aviation ou non dans ce genre de cas, toujours est-il que j’ai en tête la quasi-totalité des reportages “National Geographic” concernant les enquêtes sur les crashs d’avions. “Autoland Fail”, “Terrain”, “Pull up”, “Stall”, “Wind Shear”, simple décision des pilotes ou ordre de la tour de contrôle, je me demande ce qui a bien pu pousser les pilotes à remettre les gaz à ce point…
Si je n’ai jamais été amateur de voyage en avion, le besoin constant de “surveiller” mon vol résulte en partie des stigmates laissés par l’incident survenu en 2017 à bord d’un vol Muscat-Nairobi, alorsen route pour un Safari dans le Parc National de la capitale Kenyane. Assis au dernier rang de l’avion comme à mon habitude, cela faisais deux heures et demi que nous avions quitté Muscat. Un steward passe à coté de moi avec son chariot débordant de boissons en tout genre, café, thé, whisky et autre jus d’oranges ou de tomate. Il avance jusqu’à la moitié de la cabine et commence son service lorsque je sens soudainement mes oreilles se boucher fortement.
J’essaie de ré-égaliser à plusieurs reprises pour retrouver une ouïe à peu près normale, et comprends immédiatement que quelque chose ne va pas..
Il n’est pas normal de devoir égaliser en plein vol sans changement d’altitude, c’est même indicateur de l’un des plus grands danger en avion: la décompression. A partir de maintenant sans masque à oxygène et sans manœuvre immédiate du pilote pour descendre en dessous de 14000 pieds, l’anoxie guette.
Pour m’aider à égaliser correctement, j’attrape ma bouteille d’eau entamée avant l’incident, et alors que je dévisse à peine le bouchon, du gaz s’en échappe avec le bruit caractéristique d’une bouteille d’eau gazeuse ou de soda qu’on ouvre. Sauf que c’est une bouteille d’eau plate. Preuve que la pression dans la cabine a dramatiquement diminué depuis ma dernière gorgée. Je cherche des yeux, comme tous les passagers, quelque repère rassurant. C’est peine perdue. Même le steward qui effectuait le service dans l’allée semble inquiet, il remballe ses boissons et se précipite vers la galerie au fond du Boeing 737 qui nous transporte.
Alors que je m’apprête à le suivre pour obtenir quelques informations éventuelles, une annonce laconique du copilote grésille dans la cabine: “We’re Landing!”. Dans la seconde qui suit, l’avion amorça la descente la plus rapide qu’il m’ai été donnée de vivre lors d’un vol. Alors que nous fonçons vers ce que je pense être un “atterrissage mal barré” j’attache ma ceinture et regarde la carte sur l’écran qui me fait face. Je me rend compte que nous longeons la côte Somalienne à hauteur de Mogadiscio… et que le seul aéroport disponible a toute proximité est donc l’aéroport international Somalien. Ce séjour risque d’être bien différent de ce à quoi je m’attendais!
Si je suis le seul occupant de ma rangée de sièges, à ma droite de l’autre côté du couloir se trouve un couple de jeunes occidentaux. Alors que l’homme jette un rapide coup d’œil en ma direction je l’aborde: – “You look pretty damn calm!”
– “Yeah I’m a pilot for this company, I’m waiting the end of the descent to reach the cockpit and offer my assistance, I think there was a decompression!”
– “Is it that bad?”
– “Should be fine, a decompression is far to be as bad as what’s waiting for us in Mogadiscio!” répondit-il avec un petit sourire ironique
A ce moment précis, pour ma part je ne suis pas tellement inquiet de ce qui se passera une fois que l’on aura atterrit. Dans ces conditions, “atterrir” est la seule chose qui importe, à Bagdad ou Boston, j’aviserais sur place. Les questions se bousculent dans ma tête et je profite d’avoir un pilote à mes côtés pour glaner quelques informations complémentaires: -” Aren’t the oxygen masks supposed to drop in these conditions?”
– “Well, either, the oxygen level didn’t fall to a critical percentage, either we are going through a chain of unlikely events today! But according to the response of the pilot I’d go for the second option. By the way, what’s your name?”
– “Elias, you?”
– “Marcel, Nice meeting you! I’ll see if I can help, be right back!” Dit-il en quittant son siège.





Bien qu’il ait semblé un peu tendu pendant l’incident, son niveau d’inquiétude était clairement moins élevé que celui de nous autres, simples passagers. L’avion semblait avoir terminé sa descente infernale et s’était stabilisé. Sur l’écran, l’altitude indiquait maintenant 13500 pieds. Par le hublot, je remarque que la hauteur de l’avion nous permet de distinguer anormalement bien les détails du terrain sous nos pied. Nous n’avons pas encore entamé de virage vers l’aéroport. J’en profite pour prendre quelques photos du paysage et remarque que ma bouteille d’eau est maintenant écrasée sous la pression cabine. A 13500 pied la pression est d’environ 500hPa soit la moitié de la pression atmosphérique normale au niveau du sol. On a eu chaud.
Revenant quelques minutes plus tard toujours affublé de sa “Poker Face” Marcel se rassoit à côté de sa femme en me lançant “It’s all good, we’re not going to land here!” d’un ton soulagé.
Devant mon insistance, il prend quelques minutes pour m’expliquer la situation. Les deux moteurs de compressions tombés en panne à quelques minutes d’intervalle alors qu’ils n’auraient pas dû et les masques à oxygène qui, à contrario, ne sont pas tombés alors qu’il auraient dû. C’est la raison du piquet effectué par le co-pilote. Dans le cockpit, ils ont eu peur que tout le monde perde conscience. Arrivé sous 14000 pieds, l’oxygène est suffisant pour que l’on puisse respirer sans risque d’évanouissement, donc “tout va bien”.
– “So Why don’t we always fly under 14000ft then?” demandais-je
– “Due to the density of the air. It’s consumming a lot more kerozen to fly at a lower altitude” répondit-il en détournant le regard, trahissant une légère inquiétude.
A ma question suivante: “Then, do we have enough kerozen to reach Nairobi right now?” sa réponse ne fut que peu rassurante.
– “We’ve done the calculation three time with the pilote and the copilote. With reduced speed, and without changing weather condition, we have just enought to reach the airport. But there will be only one landing attempt possible. There is no alternative airport NBO is the closest and whatever else happening is a better option than landing in Mogadiscio…”
À l’époque, la Somalie était encore largement considérée comme une zone à hauts risques pour les voyageurs étrangers en raison de la présence d’organisations terroristes comme “al-Shabaab”, un ramassis de trou du cul avec quelques Kalashnikov, qui avaient une influence notable dans la région. Par conséquent, atterrir à Mogadiscio aurait peut-être exposé les passagers et membres d’équipage occidentaux à de sérieux problèmes. Si on m’avais demandé, j’aurais pourtant voté pour l’atterrissage, personnellement…
La clémence du climat et la précision des pilotes nous permettront d’atterrir en sécurité, avec 1h30 de retard en raison de la vitesse réduite, à Nairobi. Difficile d’expliquer le soulagement dans la cabine. Je me joindrais pour une fois aux applaudissements après l’atterrissage.
Si la fin est maintenant connue, ce vol est resté longtemps gravé dans ma tête me poussant à limiter un temps mes déplacements en avion, voir à annuler quelques vols à la dernière minute…
Ayant sympathisé avec lui, Marcel me proposera de le rejoindre pour le diner au restaurant “The Carnivore” où il se rend avec tout l’équipage. L’idée de ce restaurant très connu à Nairobi c’est de déguster un peu de certains animaux qu’il vous sera possible de voir lors de votre Safari. Une autre manière de découvrir la faune locale…










Je suis toujours perdu dans mes pensées lorsque l’avion s’extirpe enfin des nuages une quinzaine de minutes plus tard. Je reviens à la réalité alors que l’inquiétude qui régnait dans la cabine se dissipe à la vue des lumières de l’aéroport de Haikou. Nous ne sommes plus qu’à une centaine de mètres du sol et les derniers mètres s’effectuent sous une pluie battante. L’avion toujours balloté par les vents se pose avec une surprenante douceur avant de s’arrêter sur un parking à quelques centaines de mètres du terminal.
Lorsque je franchis le pas de la porte de l’avion, l’air est surprenamment frais et la légère pluie résiduelle stimulante, rien à voir avec la chaleur humide lors de mon dernier passage. Je balaye l’aéroport des yeux quelques instants, me voilà de retour à Hainan. Il aura fallu une fois de plus vaincre l’inertie de la confortable sédentarité pour déménager à travers le monde… pour de bon. Bien que les conditions soient cette fois totalement différentes de mes précédents voyages, l’appel de l’aventure est bien là. L’aventure sera certe différente, mais elle sera. Seul, en famille, sur l’île ou dans la région, en scooter électrique rose ou à cheval… nous verrons.
La Chine a toujours été aussi accueillante qu’impressionnante. Il n’est pas aisé de décrire la réalité qui m’entoure tant elle s’avère dense et diverse, bordéliquement bien organisée, profonde, intense, à la fois très luxueuse et rudimentaire. Lors de son passage ici, je pense que mon père aura toutefois synthétisé la situation avec pragmatisme :
“La Chine, c’est un peu comme si Dubaï et Imzoren étaient entrés en collision !”
L’île de Hainan, avant de devenir une province chinoise à part entière, a été le théâtre de plusieurs influences coloniales. Sous la dynastie Qing, elle est d’abord administrée par la Chine, mais au XVIe siècle, les Portugais ont brièvement établi des comptoirs commerciaux sur la côte de l’île. Au XIXe siècle, la France, qui cherchait à étendre son empire en Asie, a pris le contrôle de certaines zones côtières de Hainan à la suite des guerres de l’opium. Cependant, la présence française y est restée marginale et l’île a été rapidement réintégrée sous administration chinoise après la défaite française. Les Britanniques, de leur côté, ont eu des intérêts commerciaux dans la région, mais n’ont jamais colonisé Hainan. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’île a été occupée par les Japonais. Après la guerre, l’île a été réintégrée à la République de Chine en 1950 et est devenue une province à part entière en 1988. Aujourd’hui, Hainan est un centre touristique et économique en plein essor.
Nous quittons l’aéroport accompagné de la famille de Junya. Si j’arrive cette fois en “Terrain Connu” et accompagné, avec l’arrivée du bébé d’ici trois mois la première aventure ici sera… familiale!
Les images et le texte de cet article sont sous licence Creative Commons 4.0 international “Attribution” – “NonCommercial” – “Partage dans les Mêmes Conditions” (CC BY-NC-SA 4.0). Vous pouvez les utiliser sous réserve de respecter les conditions de la licence. Plus d’informations ici